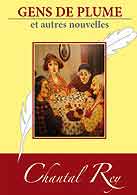
Rey Chantal Gens de plume
100 pages
A5 : 14.8 x 21 cm
sur papier 80 g offset
Style litteraire : Littéraire
Numéro ISBN : 978-2-35682-437-0
15.69
€ TTC
Frais de port inclus France
Métropolitaine uniquement
maintenant
Présentation de Gens de plume
On s’ennuyait ferme au royaume de Rânhia la Velue à une époque que l’histoire désignera plus tard comme « Les cinq ennuyeuses ».
On n’avait pas connu une telle paix depuis Césaria la Repue, dix siècles auparavant.
La déambulation parmi ces 10 nouvelles n’est ni ennuyeuse ni paisible.
Leurs protagonistes, pas plus que vous ni moi, ne sont des héros, même si la modernité décalée dans laquelle ils évoluent ne leur laisse guère de répit. Nous sommes ainsi, nous gens de plume : lorsque la muse nous chatouille, nous ne craignons pas de transformer les citrouilles en carrosses, les bécasses en amoureuses et…
Extrait du livre écrit par Rey Chantal
Sur la toile cirée graisseuse dont les antiques cicatrices étaient comblées par un magma fossile, quelques mouches rôdaient autour de l’assiette dans laquelle macérait un buvard jaune. Seul dans la cuisine, j’attendais Ernest Goudrille. Sa femme, après s’être excusée de devoir retourner à ses bêtes, m’avait assuré qu’il serait là d’une minute à l’autre. J’en profitai pour peaufiner mon article sur la controverse suscitée par le projet d’aménagement de la place du foirail, ceux qui militaient pour la topiaire en forme de fusée s’opposant aux tenants du baobab nain. Ces exercices journalistiques n’étaient pas mes préférés, mais il fallait bien gagner sa vie. Entre les ateliers d’écriture que j’animais bénévolement à l’hospice du Soleil Couchant, quelques lettres de réclamation à la MSA (*) et la tenue des registres de la mairie, j’assurais la correspondance locale du « Rural Indépendant ». Ma vocation était la littérature romanesque et à cette époque-là je sentais que ma plume frémissait d’écrire l’œuvre de ma vie, aussitôt que j’en aurais trouvé le sujet. Cela allait venir, il ne fallait rien précipiter. Je n’avais que 58 ans, et voulais éviter l’écueil des œuvres de jeunesse. En attendant, je devais continuer à exercer mon art sans négliger les contingences matérielles de la vie. C’est ainsi que je me retrouvai chez Ernest Goudrille, en ce matin de septembre 1964, pour y recueillir des révélations à propos d’une mystérieuse disparition.
Mon informateur, pur produit du terroir, n’avait jamais quitté la ferme familiale. A la mort de son père, sa mère le persuada qu’il lui fallait des bras pour s’occuper de son élevage de palmipèdes. Une marieuse de sa connaissance lui trouva des bras. Au bout des bras il y avait Jeanine, la fille de l’inséminateur, dont le voisinage s’accordait à dire qu’elle n’était certes pas jolie, mais qu’elle était « plus vaillante que certains hommes ». Le mariage fut un succès dans la mesure où Jeanine, honorant la réputation qui l’avait précédée, transforma une ferme de subsistance en une florissante exploitation agricole. Quand Ernest fit valoir ses droits à une retraite selon lui bien méritée, Jeanine endossa le statut officiel de chef d’exploitation, ce qui ne modifia guère son quotidien. Cela ne changea pas grand-chose non plus au quotidien d’Ernest, qui continua à partager son temps entre ses parties de pétanque et ses puzzles représentant tous des scènes champêtres. Bien que n’en sachant pas plus sur l’individu, je me doutais que sa vie fût dénuée d’intérêt ; pourtant mon expérience de journaliste de terrain m’avait appris que sous l’eau stagnante pouvaient se trouver d’insoupçonnables remous. Je sentais par ailleurs, en toute modestie, que l’occasion allait m’être donnée de montrer à quel point le brio de ma plume pourrait transformer un fait anodin en une fresque romanesque. Après tout, Gustave Flaubert n’avait pas fait autre chose en relatant un épisode de la morne vie de cette bécasse d’Emma.
Alors que j’hésitais entre « Soyouz » et « Gemini », Ernest Goudrille fit irruption dans la pièce. Il me salua à peine en prenant deux verres dans un buffet, ainsi qu’une bouteille à la transparence vaincue par la saleté. Tandis qu’il remplissait les verres, il me confia sans ambages qu’il savait qui avait fait le coup. Devant mon étonnement, il précisa qu’il savait qui l’avait tué. Je ne lui cachai pas que je trouvais ses paroles énigmatiques, mais il s’emporta, déclarant « qu’y fallait pas le prendre pour un con, que la vérité allait péter, que ça allait faire du raffut, et qu’alors la justice se mettrait en branle et qu’y aurait plus qu’à attendre qu’elle fasse son boulot ». Je n’insistai pas, attendant qu’il se calmât pour m’expliquer l’affaire, me contentant pour l’heure de lui demander qui avait disparu, puisqu’il était question de disparition. Il me répondit :
- Un être « èt-cèt-cionnel ».
Précédée par un balai espagnol à pattes tout droit sorti d’un bain de boue, Jeanine entra, nimbée d’une âcre odeur de lisier, alors qu’Ernest évoquait la naissance du disparu :
- Tombé du ciel, pauvre ! Assurément en route pour l’Afrique, passequ’on était fin novembre. Y z’ont dû s’arrêter pour se reposer et après, vous savez ce que c’est, y foutent le camp, sauf un.
Non, je ne savais pas ce que c’était, justement, et j’aurais bien aimé comprendre qui étaient les « y » dont il me parlait. Jeanine nous tournait le dos, occupée à savonner ses mains, faisant pleuvoir des coulures de purin sur la vaisselle sale qui encombrait l’évier. Elle s’exclama :
- L’Afrique, tu parles ! L’ampoule de la couveuse qui a grillé, oui ! Et çui-là, il était à la traîne. C’est bien simple, il a fallu le finir à la main.
La confusion de mon esprit était telle que je fus pris d’inquiétude à l’idée que ces gens, que je ne connaissais que de nom, m’avaient peut-être fait absorber le jus d’une étrange treille. Plus ils parlaient, moins je comprenais. Mon air hagard semblait intéresser le balai à franges boueux qui fixait sur moi ce que je pris pour des yeux. Refusant poliment un deuxième verre de la piquette suspecte, j’ouvris mon cahier et m’armai de mon crayon, prêt à faire des croquis si nécessaire pour essayer d’y voir plus clair. Il me fallait en premier lieu identifier le personnage : qui était-il, d’où venait-il, quelle était la nature de sa relation avec mon interlocuteur ? Tout d’abord le nommer. Je demandai à Ernest Goudrille s’il souhaitait que l’on mentionnât la véritable identité du disparu ou s’il préférait utiliser un nom d’emprunt.
- Y faut mettre son nom, pardi ! Saturnin.
Il ajouta : « J’ai rien à cacher, moi », en lançant un regard de défi à sa femme qui, de l’autre côté de la table, avait entrepris d’éviscérer un poulet sur un journal sanglant. Les relents qui émanaient des entrailles tièdes du volatile me firent presque regretter la puanteur du lisier qui s’était estompée. Jeanine m’adressa un sourire bienveillant :
- Ça va vous changer des chiens écrasés, pour une fois. Et pour un journaliste, pondre un article sur un canard, c’est marrant, non ?
Derrière ce subtil trait d’esprit, je finis par saisir le fin mot de l’histoire : Ernest Goudrille attendait de moi rien moins que la rédaction d’un article dont le protagoniste était un canard ! Mon premier mouvement fut de quitter les lieux sur le champ, faisant fi de l’outrage que l’on tentait d’infliger à mon honneur d’écrivain, mais je me ravisai au souvenir du solde de mon dernier relevé bancaire. Après tout, pourquoi un canard n’eût-il pas été digne de ma plume ? (Tiens, l’humour de Jeanine serait-il contagieux ?). Mon éthique ne m’autorisant pas à juger a priori de la pertinence des sujets que l’on me confiait, je m’apprêtai, la mort dans l’âme, à relater l’existence bucolique d’une volaille. Suggérant de laisser de côté le débat sur les circonstances de son apparition, je m’enquis de la suite des événements, pressé d’en venir à la finalité de l’article : la disparition. J’avais résolu de traiter le sujet chronologiquement. La démarche manquait certes d’originalité, mais il me semblait que ce fût la forme qui s’imposait en l’occurrence. J’appris ainsi à quel point l’enfance de Saturnin fut tourmentée. Comme le vilain petit canard du conte, Saturnin fut rejeté par ses semblables, probablement en raison de sa petite taille. Ernest trouvait normal qu’un canard sauvage fût plus svelte qu’un vulgaire mulard d’élevage. Jeanine prétendait pour sa part qu’il était chétif avant même de naître, et que la panne de couveuse n’avait rien arrangé. Elle précisa que lorsque l’ampoule grilla, tous les œufs venaient d’éclore, sauf un, auquel elle donna littéralement un léger coup de pouce avant d’aller mettre la couvée au chaud sous l’édredon de son lit.
- Si j’avais rien fait, il y serait encore, dans sa coquille, ce grand feignant !
Ernest me pria de ne pas accorder de crédit aux calomnies de sa femme qui n’était qu’une horrible mégère dévorée de jalousie, et poursuivit son récit. Le canard, rejeté par ses pairs, se prit d’affection pour Ernest et sa mère, la vieille Ernestine qui restait dans sa chambre à grignoter des gâteaux secs devant la télévision. L’homme et l’animal devinrent tellement complices que bientôt nul ne s’étonna plus dans le village de voir la démarche d’Ernest se régler peu à peu sur le dandinement de son compagnon. D’après la servante de l’abbé, que j’eus l’occasion de rencontrer plus tard, ce curieux attachement était une stratégie de l’inconscient d’Ernest pour racheter ses fautes. Selon elle, ce Saturnin tombé du ciel, pour quelqu’un qui avait gavé et tué tant de canards, ce ne pouvait être qu’un signe du Très Haut.
