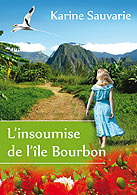
Sauvarie Karine L'insoumise de l'île Bourbon
416 pages
A5 : 14.8 x 21 cm
sur papier 80 g bouffant ivoire
Style litteraire : Roman
Numéro ISBN : 978-2-9558927-0-1
22.56
€ TTC
Frais de port inclus France
Métropolitaine uniquement
maintenant
Présentation de Sauvarie Karine
éditeur de L'insoumise de l'île Bourbon
J’ai toujours aimé écrire. Mon plus ancien souvenir remonte à l’âge de sept ans : sur un petit carnet, je consignais ma première histoire. Mon enfance a ainsi été marquée de poèmes et de petites pièces de théâtre. J’ai fait quelques nouvelles lors de mes années collège et de nombreux récits durant mon adolescence puis un premier roman que j’ai mis en attente de longues années…
J’ai alors laissé ma vie m’enrichir de multiples expériences, des plus tristes aux plus belles, elles se sont posées sur moi en me laissant bien des empreintes.
Professionnellement, du secrétariat, je suis passée au paramédical et je prépare maintenant une licence dans le domaine social. Aujourd’hui à l’âge de 43 ans, c’est avec un grand bonheur que je vous livre ce premier roman.
Présentation de L'insoumise de l'île Bourbon
Hélène Deboisvilliers voit le jour en 1775 à l’île Bourbon. Au sein d’une famille de grands propriétaires terriens, producteurs de café, elle aurait pu être heureuse si un drame n’avait pas accompagné sa naissance. Ainsi, elle grandit au croisement de deux mondes que tout oppose, celui des colons et celui des esclaves.
Elle passe son enfance à « La Providence » entourée de sa grand-mère Mathilde à qui elle voue une profonde affection, de sa nourrice Sélisse et de son amie Mady. Lorsque son précepteur, Raphaël, lui fait découvrir les écrivains du siècle des Lumières, en même temps que ses premiers émois amoureux, elle se prend de passion pour ce mouvement intellectuel.
Dès lors, elle n’a de cesse de s’impliquer et d’éveiller les consciences pour que l’être humain soit respecté. Mais son engagement est si grand qu’elle sombre elle-même dans la dépression et la misère. Un soutien inattendu lui permettra de retrouver un regain d’énergie et de combativité pour aller encore plus loin et voir le rêve de sa vie se réaliser.
Un roman qui vous emporte sur l’île de La Réunion, pour vous faire découvrir sa culture, ses paysages, ses parfums, ses couleurs… mais aussi une partie de notre histoire. Un voyage émouvant qui vous invite à poser un regard critique sur la nature humaine et sur la société.
Extrait du livre écrit par Sauvarie Karine
« Je fleurirai là où je serai portée »
Telle était la devise de la Compagnie Française des Indes Orientales.
1775, sur l’île Bourbon, dans l’Océan Indien, à l’Est des côtes de Madagascar :
Le soleil écrasant conjugué à l’humidité de l’air enveloppait l’île d’une atmosphère harassante. Dans les plantations, les corps luttaient contre l’atonie.
Le domaine de la famille Deboisvilliers s’étendait sur de nombreux hectares. Le café, le coton, le riz, le blé, les haricots et le maïs y étaient cultivés. De l’aube au crépuscule, une centaine d’esclaves s’affairait chaque jour dans ces champs, sous l’œil vigilant des régisseurs et des commandeurs. Epuisés mais résignés, dans la plus grande indolence, les domestiques se soumettaient aux exigences de leurs maîtres. Répétant les mêmes gestes, recevant les mêmes brimades, comme le roulis des vagues jetant son écume sur la plage à l’infini, leur sueur se répandait sans relâche sur les cultures des grands propriétaires terriens qui exploitaient leurs forces jusqu’à la mort.
La propriété, baptisée Providence, était splendide. Elle longeait la rivière des Marsouins sur plusieurs kilomètres, au-dessus de la ville de Saint-Benoît. Bordée, en partie haute, d’une forêt primaire aux bois de couleurs, elle se prolongeait à travers les champs de cultures vivrières, entrecoupée de bosquets de tamarins et de calumets. Des cotonniers et des caféiers atteignaient le parc. Une étendue immense de soyeuses boules blanches mêlées aux baies jaunes et rouges précédait le verger. Les nombreux arbres fruitiers, manguiers, citronniers, figuiers, papayers répandaient dans cet enclos une multitude de couleurs et de saveurs. Deux rangées de palmistes alignées de chaque côté d’un sentier franchissaient une petite colline conduisant à une immense bâtisse coloniale en pierre basalte.
Immaculée, érigée sur trois étages, cette demeure abritait l’ensemble de la famille Deboisvilliers. De grands hibiscus, des anthuriums et des orchidées longeaient une spacieuse terrasse couverte qui s’ouvrait en façade. Il s’agissait d’un espace paisible meublé d’un salon en rotin dont trois fauteuils à bascule. Fermée par des piliers et des garde-corps sculptés dans le basalte, cette plate-forme que l’on appelait la varangue agrémentait la demeure avec beaucoup d’élégance. Un large escalier menait jusqu’à son seuil. Cette maison coloniale était l’une des plus luxueuses de l’île.
Au deuxième étage de cet imposant édifice, Maximilien, le fils de cette famille, faisait les cent pas dans le boudoir contigu à la chambre de son épouse. Le médecin venait d’y entrer. L’attente, mêlée de joie et d’inquiétude, lui semblait interminable.
Maximilien, qui gérait l’exploitation familiale depuis quelques années avec l’aide de son beau-frère, avait rencontré Madeleine lors d’un voyage en France. Il en était tombé éperdument amoureux et, par chance, cette dernière avait accepté de le suivre sur son île pour devenir son épouse. Ils avaient ensemble le projet de fonder une grande famille et ils souhaitaient faire prospérer la plantation. Ils envisageaient de développer de nouvelles cultures et de réaliser de nouveaux investissements.
Grand, élégant, le regard pétillant, Maximilien était le deuxième d’une famille de quatre enfants. Sa sœur aînée, Louise, vivait également à la Providence avec son mari Edouard, tout comme leurs deux jeunes frères jumeaux, Paul et Francis, qui étudiaient encore et s’apprêtaient à entrer au Collège royal Louis le Grand de Paris.
Leur mère, Mathilde, était une dame fatiguée, qui se déplaçait difficilement. Des douleurs diffuses irradiaient continuellement l’ensemble de son squelette. Elle ne se séparait plus de sa canne.
Usée par des années de soumission masquées par un élégant statut social qu’elle avait tenu à préserver pour protéger les siens, elle se réjouissait à présent, d’être si bien entourée par ses enfants et bientôt ses petits-enfants. Sa vie, aux côtés de son époux Henri, fut pénible. L’homme sévère et intransigeant ne supportait aucune opposition. Favorisé par un bel héritage, il menait sa vie instinctivement. Mathilde vécut dans son ombre. De son côté, elle était issue d’une famille pauvre où la survie, grâce au travail acharné, était la seule préoccupation. Elle ne pensait avoir aucune valeur et n’être de ce monde que pour servir et subir. Ainsi s’était-elle engagée avec cet homme qui lui offrait une vie cossue, pensant à ce moment-là saisir une opportunité extraordinaire et bénéficier d’un véritable privilège. Elle dut se ranger aux côtés d’une communauté qu’elle ne comprenait pas toujours et avec laquelle elle ne partageait pas les mêmes valeurs. Elle fit beaucoup de sacrifices. Finalement, depuis le décès de son époux, même si elle en était profondément affectée, elle donnait l’impression de revivre.
Assise près de sa belle-fille, Mathilde lui tenait la main. Madeleine était pâle. Elle adressait de temps à autre à sa belle-mère quelques sourires candides et des regards inquiets. Toutes les deux entretenaient une jolie complicité qui renforçait les liens familiaux. Le médecin se concentrait sur sa tâche, tandis qu’un silence presque religieux remplissait la pièce. Louise était à leurs côtés, participant de son mieux au travail qui se préparait.
Dans la pièce voisine, Maximilien ne cessait de s’agiter. Ses pensées s’enchaînaient, troublantes, furtives, d’un sujet à l’autre, sans jamais s’apaiser. Il ne se souvenait pas s’être déjà senti aussi nerveux. Ses mains tremblaient, ses mouvements s’accéléraient, il se sentait terriblement oppressé.
Edouard, voyant son beau-frère dans cet état d’anxiété, prit la parole :
- Je suis allé à Saint-Denis hier. Il y avait un monde incroyable dans la droguerie. Ils ont reçu de nouvelles marchandises : toiles, poteries, outillage. Elles se vendent enfin à des tarifs plus raisonnables.
- Il était temps que la Compagnie des Indes rétrocède l’île au Roi, mais le gouverneur a encore du travail pour rétablir le marché, lui répondit Maximilien d’un ton monocorde.
- De toute façon, la compagnie était ruinée ! Depuis le traité de Paris en 1763 et depuis que la France a perdu ses territoires de Deccan en Inde, elle a décliné !
- Reste à savoir ce qu’il adviendra de nous ? s’interrogea Maximilien, songeur.
- Ah… il est vrai que les pucerons détruisent une partie de nos plantations, et le quart sud des caféiers présente un feuillage tacheté. Je crains qu’une nouvelle maladie ne décime une quotité de la récolte ! De toute façon, quoi que nous fassions, nous ne pourrons jamais rivaliser face aux Antilles ! Nous sommes à 2 600 lieues de la France, tandis qu’elles ne sont qu’à 1 200 lieues de Bordeaux !
- C’est sûr, et le cours du café ne cessera pas de baisser.
- L’impôt sur l’achat d’un esclave est à présent de 40 sols.
- Si encore la commune se chargeait correctement de la capture des fugitifs !
- Elle organisait un détachement aujourd’hui.
- Ah ? Et d’où sont partis les marrons 2 ?
- De chez Raymond Hoareaux.
A ce même moment, un hurlement de nourrisson se fit entendre.
- On dirait que vous venez d’être papa, cher beau-frère ! reprit joyeusement Edouard. Toutes mes félicitations !
Maximilien se figea, les yeux rivés sur la porte de la chambre. Il avança d’un pas, puis attendit.
- Ils ne vont pas tarder à sortir ! le rassura Edouard.
- Cette attente devient impossible ! rétorqua Maximilien d’un ton sec.
Un long silence s’installa. Edouard, tapi dans un coin de la pièce, ne savait plus où poser le regard. Petit homme brun à l’ossature généreuse et quelque peu enveloppée, il portait de grandes
2 Nom donné aux esclaves fugitifs
moustaches qui lui couvraient le tiers du visage et retombaient sur de belles joues rondes et roses qui trahissaient sa gourmandise. Cet hédoniste sympathique vouait un profond respect à son beau-frère qui l’avait très vite intégré dans le cercle familial, mais celui-ci, à présent surexcité, le rendait également nerveux.
- J’ai décidé de consacrer une parcelle de terre à la culture des épices en l’honneur de mon fils ! reprit Maximilien avec fierté. Nous y ferons de la muscade, du poivre, de la cannelle et du gingembre. Les domestiques vont pouvoir commencer à travailler le terrain.
- Allons ! allons ! cher beau-frère, n’allez pas si vite en besogne, il se peut que ce soit une fille !
Soudain la porte s’ouvrit. Sur son seuil, le médecin apparut, l’air grave, il s’avança vers Maximilien et baissa la tête. Des sanglots envahirent la pièce.
Maximilien pétrifié bredouilla :
- Que se passe-t-il ?
- Je suis désolé. Votre épouse était très faible. Son cœur s’est arrêté.
- Madeleine ? Mais ce n’est pas possible, pas Madeleine !
Maximilien se précipita vers sa bien-aimée. Son frêle petit corps paraissait détendu ; un léger sourire dessinait sa bouche rose pâle. Ses paupières refermées, elle semblait se reposer. Il plaqua son oreille contre son cœur puis s’effondra en larmes. Il sentit ses jambes se dérober, comme si le sol, tout d’un coup, s’ouvrait sous son poids, engloutissant ce qui lui restait de raison. L’air implacablement lourd l’étouffait. Tout ce qui l’entourait s’immobilisa brutalement dans une image difforme, décomposée, lui paraissant irréelle et enveloppée d’un épais brouillard.
Au dehors, le labeur acharné des esclaves se poursuivait, et déjà, la nouvelle, galopante, courait les champs de bouche-à-oreille. Une agitation s’emparait de la population. Les régisseurs s’étaient rejoints, relâchant l’attention sur la plantation. Ces deux anciens marins travaillaient depuis plusieurs années au service de la famille. Ils en connaissaient toute l’histoire. Chargés de faire régner l’ordre et de maintenir les cadences, ils conservaient sur le groupe d’esclaves un regard extrêmement vigilant. Pour cette tâche, qui nécessitait l’inspection de plusieurs hectares, ils se faisaient assister de quelques commandeurs noirs : des esclaves particulièrement obéissants, auxquels les maîtres accordaient quelques faveurs, en contrepartie de délation. Ils se montraient excessivement dissuasifs envers ceux de leur race, et ce, dès la première incartade. Bien souvent les luttes meurtrières qui en résultaient nécessitaient leur renouvellement. Ceci arrangeait parfaitement le maître, lui permettant ainsi de maintenir sur son domaine un ordre drastique sans avoir à déposer plainte officiellement auprès du procureur, comme le prévoyait théoriquement le code noir.
L’accouchement de Madeleine laissa une trace douloureuse dans la famille Deboisvilliers. Abasourdi, chacun réagit à sa façon, pour gérer l’effroyable réalité.
Seule Mathilde parut se soucier de l’enfant. Le nourrisson, affamé, commençait à répandre dans la bâtisse des hurlements stridents. L’humeur de Maximilien oscillait entre l’anéantissement et la colère. Les cris répétés de son enfant l'irritaient. Déjà, il projetait sur ce nouveau-né toute sa rancœur.
La première difficulté se présenta au moment de l’allaiter. Ils essayèrent le lait de vache, mais le nourrisson, rapidement pris de vomissements et de diarrhées, mit ses jours en péril. Une domestique venait d’enfanter depuis à peu près une semaine, et sur les conseils du médecin, il fallait lui présenter l’enfant. A ce moment-là, l’idée de nourrir une petite fille blanche au sein d’une esclave les terrifia. Louise entreprit une recherche hâtive auprès de la population blanche. Les femmes venant de France étaient encore peu nombreuses. Elle n’en trouva aucune qui put allaiter le nouveau-né.
Finalement, Mathilde fit venir l’esclave et son enfant, qu’elle décida d’installer dans la maison :
- Cette chambre ira parfaitement, indiqua-t-elle au médecin.
L’esclave, réquisitionnée, entra dans la pièce, en tenant son enfant dans ses bras. Cette jeune Africaine d’une trentaine d’années
se retrouva brusquement propulsée dans un nouvel environnement. Elle observa autour d’elle la pièce, le médecin, sa maîtresse, l’air hagard.
- C’est une fille ? lui demanda Mathilde.
- Oui Madame, lui répondit l’esclave en serrant plus fort son enfant contre elle.
Témoignage sur l'autoédition de Sauvarie Karine
Entreprise sérieuse. Respect des délais et travail soigné. Je recommande l'impression de vos livres avec le groupe CCEE Autres Talents et je les remercie de m'avoir permis de passer du rêve à la réalité.
